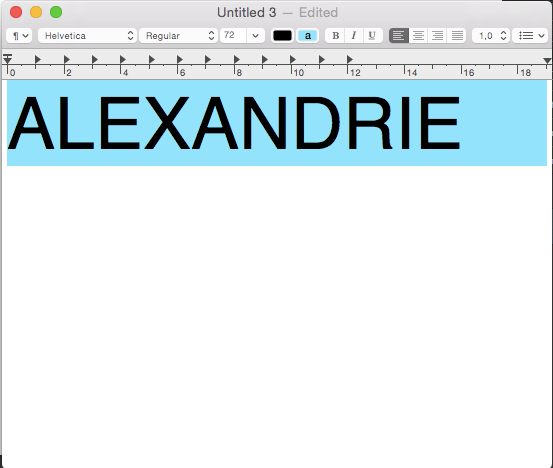
Mon laconisme tient en une phrase.
Ma pratique d’écriture n’est pas qu’un à côté, c’est une manière de mettre en forme les idées avant de les tirer vers des solutions plus performatives

Entre deux et trois kilomètres de temps passé…
…représente une tentative d’épuisement d’un stylo autour du déploiement de la ligne.
Le projet sur un rouleau de papier de cinq mètres de longueur voit se déployer la ligne en une spirale, elle devient la forme d’une écriture qui ne vaut que pour elle même. Les lignes devenues circulaires donnent l’illusion de sculpter le vide de la page blanche : en réalité une seule ligne qui se démultiplie en tournoyant.
La musicalité de toute langue médiée par l’écriture demeure ici strictement visuelle en ce qu’elle se réduit au rythme tournoyant du tracé. C’est un silence contemplatif mais visuellement dense qui envahit l’espace de l’écriture.
L’écriture comme geste, devient un mouvement que l’on quantifie, que l’on porte en durée. C’est un temps dilaté d’entre deux et trois kilomètres, ce qui représente la longueur potentielle d’une ligne droite traçable à l’aide d’un seul stylo.
Texte et dessins publiés dans :
An Anthology of Asemic Handwriting, Edition : Uitgeverij,2013
Entre deux et trois kilomètres de temps passé» in Nioques. T 9/10, le mot et la chose, 2012
Spécimen A
Le trou de la Parrhèsia[1] : l’artiste est mortel.
L’ennui et l’aridité sont les deux formes qu’aura revêtu le paradigme post-moderne au 21ème siècle. Le transhumanisme a rejoint les archives des utopies prétentieuses et l’être humain en est plus que jamais réduit à se prendre lui-même pour esclave.
L’œuvre Playformers, décrépit à la mesure de son interface visuelle, renvoie au spectateur ce qu’il s’est donné du mal à être depuis les cinquante dernières années : un a-sservi-teur d’algorithmes, un sourceur de recommandations, un chercheur d’alchimistes plutôt qu’un chercheur d’or. Pourtant biberonné aux écoles de Francfort[2] et autres pensées marxistes et French théories, son interlocuteur le spectateur émancipé, s’est quant à lui enchainé aux divertissements issues des apps de la Silicon Valley (nom que l’on donnait au regroupement des premières multinationales du tout-numérique-tout-en-baskets-New-Balance). Le web (x.0 +∞) a tissé une toile sur les rétines de ces brebis gavées. L’affrontement, entre les théories de l’influence et de la réception, n’aura pas essaimé de nouveaux paradigmes de consommation des biens culturels mais elles ont déplacé le curseur de la mise en visibilité des processus de domination. Les industries créatives ont fait preuve de l’art bien connu du néo-libéralisme pour asservir, faire plier le roseau contre le chêne, à coup de rhétorique jubilatoire et transgressive qui rend impalpable le processus d’asservissement qu’elle engendre. Impalpable la domination parce que voulu. Le glissement sémantique de la catégorie BDSM dans le champ politique en dit long sur le paradigme récent qui chamboule notre société et bien évidemment l’art.
C’est donc l’artiste qui se mute en souffre douleur soumis à ces industries culturelle, à ces Léviathans tentaculaires qui donnent du beau des définitions statistiques et algorithmiques. Au plus offrant, les déambulations lascives sous acides d’artistes n’ayant pas dormi depuis 72 heures, les corps cloués aux poteaux d’un but de football lors d’un match de coupe du monde, les parties fines de tire à l’arc qui fabriquent des amazones artisanalement. Les vidéos des actionnistes viennois tournent en boucle dans les écoles et la souffrance qui exprimait une métaphysique de la profondeur, se trouve réduite, dans notre société, à demeurer surfacielle, à se déployer sur les écrans des téléphones, des télévisions, des ordinateurs, des casques VCR et des holoscrens. On a chassé l’expérience de la chair en la réduisant à une médiation écranique.
Lorsque l’artiste, alors qu’il marche dans la rue, se fait simultanément sodomiser tour à tour par des inconnus aux pénis en réalité augmentés, c’est à la surface des écrans que la métaphysique affleure et que tous se répandent (#SCREENCUM). L’écran qui représente la limite physique de l’enfermement des possibles vient questionner l’écran comme ouverture impalpable des rengaines de l’extrême et des hybridations, comme autant de gestes artistiques en vue de signifier au monde qu’il y aurait des modèles de calculs qui agirait encore comme des cadavres exquis.[3] Comme si la performance qui a connu son apogée dans les années 2025 venait se cogner aux interfaces digitales, aux algorithmes structurants et qui vident le corps de ces affects et de ces sécrétions. Il demeure des actions leur archivage, c’est-à-dire la dernière preuve concrète du geste de discrimination et de sélection de l’artiste face au monde.
Le geste et la clameur poétique du fond des wires exhaltent : #moneyworthholes, #DPDPDG, #politique, #scarification, #penetrationanale, #tube, kalashnikov, #bondage…ou encore par catégories : 3D _ Automutilation _ Chant _ Danse _ Discours _ Extérieur _ Féminisme _Groupes _ Historique _ Poétique _ Réalité…
Spécimen A manie l’automutilation à chaque fois qu’un mécène lance une demande de live en réunion et ce jusqu’à ce ces intestins lui sortent par la bouche. Nous pourrions qualifier le geste de l’artiste de carnavalesque[4] effectif, dans la mesure où, puisqu’il ne peut plus changer de corps social, il fait advenir l’intérieur de son propre à la surface des écrans, nouvel incarnat de la société civile. Et lorsqu’il se fourre la tête dans son intestin grêle, on devine les airs d’ancienne musique punk qu’il joue de ses derniers souffles malodorants à l’intention d’un tiers distrait et méprisant. Mais nous sommes dans un monde privé d’ennemis concrets et le geste d’automutilation témoigne de la perspective critique laissée aujourd’hui à l’artiste : la mort ou la mort, comme levée de Rideau.Le sacrifice des artistes c’est la corrida du néo capitalisme triomphant – et cmdZ ne le ressuscitera pas. En témoigne le #mortendirect qui sur Playformers rencontre le plus de vue (près de 6000 millions à ce stade). Disparaître l’artiste doit-il, dans une révérence si possible macabre. On se souvient de l’injonction lancée dans le Salo de Pasolini « E allora mangia la merda », mais sur Playformers ce qui représentait à l’époque le summum de l’évocation des tortures nazi, ne rencontrerait aujourd’hui pas le moindre trafic. Devons-nous en conclure que l’art de la torture est une forme culturelle comme une autre, vouée à se périmer ? Comme tout élément d’une sous-culture temporaire sa péremption est inévitable. Sauf que, et c’est le paradoxe que nous souhaitons souligner, les outils de torture sont les seuls que la société laisse désormais à disposition de l’artiste.
[1] La Parrhèsia est un terme qui vient du Grec pour dire « parler de tout ». D’après Michel Foucault, c’est une parole de vérité. C’est « le courage de la vérité ». L’artiste parce qu’il a été la vérité du discours de la société est aujourd’hui mis à mort par celle-là même qu’il n’a cessé de mettre en garde. Pour reprendre Foucault pourrions-nous résumer ainsi la place de l’artiste aujourd’hui : « Un homme par conséquent qui parle pour des motifs nobles, et qui, pour ces motifs nobles, s’oppose à la volonté de tous, celui-là, dit Socrate, s’expose à la mort »
[2] On désignait par ce terme un groupe de philosophes Allemand qui émirent les premières critiques envers les industries culturelles critiquant notamment l’unidimensionnalité des propositions médiatiques.
[3] Le cadavre exquis est une forme poétique du début du XXème siècle qui favorise les libres associations d’idées dans la fabrication des textes.
[4] Pour reprendre un concept très en vogue dans la deuxième moitié du XXème siècle, le terme carnavalesque a été proposé par Backhtine pour qualifier un motif de renversement des valeurs et de bouleversement des codes sociaux.
Texte publié dans le recueil de Catalogues 2017 2033 par Sébastien Souchon
Pour : à propos de Nice (Jean Vigo)
Il y a toujours de la joie quand il y a du soleil, la chaleur du ciel, les fumées et l’irradiation n’auront pas raison d’une fièvre populaire, tendue vers l’acceptation de sa liberté, de sa croissance. Et la foule qui grouille dans les rues, ma foi se rassemble pour fêter la disparition des nuages. Chaque petite entité individuelle vit une expérience qui se surajoute à celle de la communauté. Un large sourire s’étiole près des usines en feu. Un trou soudain brise le destin commun de la joie : les immeubles s’écartent et c’est tout une époque qui se dépose sur la pellicule.
Oh un ouragan de mini jupes. Comme les filles se secouent quand il y a des percussions. J’ai remarqué que les fêtes donnent aux demoiselles les joues rouges. Elles marquent le sceau du carnavalesque sur leur visage. C’est ce que l’on appelle le rayonnement. Tant qu’elles ne sont pas mariées, elles vivent sereinement la musique et elles gigotent. Plus tard la capture maritale les immobilisera. Et elles fuiront les exercices, la danse, les mouvements musculaires. Elles regarderont par la fenêtre et personne ne viendra.
La gentrification, les ombrelles, et les chaussures en cuir n’auront pas raison des marcheurs et des vacanciers. Ils luttent avec leur porte-monnaie pour se faire une place au soleil et près des marchands de glace. Voir en étant regardé est un motif d’occupation temporaire du bord de mer. On converse alors les uns avec les autres. Oh le grand monsieur, ah la dame au chien mal aimable, voilà une jolie jeune fille, le monsieur a l’air important, tiens c’est Yvonne qui discute avec un jeune homme : elle a les bas filés. On retient ses expansions on cherche à se faire voir. C’est un hobby comme un autre mais c’est un loisir du bord de mer.
Textes écrits pour la bande son d’un ciné concert lors de la journée « Des corps qui piquent », organisée pour le mois du film documentaire par les Froufrous de Lilith, 2015
A défaut de savoir où je vais dans la vie, je vais à la piscine
Je nage plutôt mal et pourtant j’aime aller à la piscine. Parce que je mets des bouchons d’oreille et que plongée dans l’eau qui rend sourd, je rumine seulement des bras qui s’arquent devant les petits flots provoqués par les pieds malhabiles du voisin de devant. C’est également un lieu où je ne porte aucune attention aux autres alors qu’ils sont paradoxalement presque nus, donc voyants c’est-à-dire saillants par la chair, et pourtant ils deviennent invisibles, petits bouts de corps qui s’échinent à transpirer-ironiquement-dans l’eau. Ce sont des mouvements à lunettes, aux bonnets sombres et discrets qui se fraient dans les lignes des sensations de calme. Parfois j’en maudis un qui ne tient pas sa ligne ou une qui choisit de faire du dos aveuglément et maladroitement mais sûre d’elle manque à plusieurs reprises de me rentrer dedans. Je leur reproche silencieusement un manque, du savoir vivre que je m’invente en piscine. Tenir sa ligne, la vitesse de sa ligne, l’alignement et le rythme de sa ligne, sa ligne, obsession du point, du point de vue des allers-retours signifiants. Et une heure passée dans le grand bassin, à la minute près je sors, je file vers les vestiaires avec l’imaginaire tendu en vue d’un prochain retour sous l’eau où contemplant le fond de la piscine, je me sens à ma place. Comme si les saillies métaphysiques s’alignaient avec mes bras et que seule la respiration me dit que l’expiration est dans deux mouvements. Il y a un anéantissement profond, à la surface de l’eau, des questionnements ayant trait au sens de la vie. Car dans l’eau, comme dans une seule et même matière, c’est l’écosystème du silence qui nous anesthésie. La piscine n’est pas une substance hallucinogène ni hilarante, c’est le souvenir vague d’un rêve qui implique l’enfance. Le lit d’un lichen de corps qui affleurent et qui comme la nature trouvent ce qu’ils n’ont plus besoin de chercher : la respiration.
Texte publié dans le recueil « Sur la page abandonnée » aux Editions extensibles, 2016
Le fameux nivellement par le bas
L’idéologie « petit bourgeois » a infiltré l’ensemble de la société à tel point que cette dernière est devenue soluble dans l’ennui.
Le premier indice de cette transfiguration vers un confortable mais monotone art de vivre c’est la domination du terme « petit » dans les usages du quotidien : des jeunes filles portant des jeans de petites tailles vont se prendre un petit verre en petit comité dans un petit bar qui fait des petites bouchées. Aujourd’hui elles ont lu un petit post Facebook ce sont les petits changements qui font les grandes révolutions, en se prenant un petit temps de pause.
Petit c’est toujours la fronde du trop, comme si la peur de cette idéologie c’est le débordement. Alors la tranquillité s’installe dans le langage : un petit chien, un petit moment, un petit ami, un petit dessert, un petit weekend. Puis elle passe par le rythme : un petit moment et de l’ambition donne une petite augmentation. C’est une idéologie centrée sur l’individu comme un soi dont il faut prendre soin, une sorte de poupée à materner à coup de compléments alimentaires, d’assiettes en petites portions, de tisanes et de vêtements minuscules. Prenons par exemple l’existence d’une taille XXS, dont la formulation n’a d’égale que l’absurdité dont elle plonge le culte du mince. XS c’est l’agrandissement de la minceur, deux fois plus petit, l’infiniment petit, la plongée dans le microscopique, autant dire que la taille XXS c’est la disparition dans le réel.
Aussi l’idéologie petit bourgeois est-elle celle qui excuse d’être en vie, elle dessine des individus qui mettant un pied dans la ville se demandent s’ils ne vont pas l’abimer, suivent à la lettre les consignes de sécurité et se damnent auprès de toute autorité qui leur donne un mode de vie et des horaires qui les sécurisent.
L’idéologie petit bourgeois est celle du contentement. Cela ne signifie pas un manque d’ambition mais cela veut dire la complaisance à être soi et s’afficher avec l’ampleur d’un paon et la silhouette d’une poule d’eau.
Extrait, texte publié dans la revue L’Epine, Novembre 2016
La formation des concepts
LUNDI
Petit Déjeuner : Lait, eau, céréale. La terre est encore plate.
Déjeuner : Un peu de tout, arche de Noé. Des pluies de sauterelles.
Dîner : Agneau, un pot de bière devant michel-ange à la télé.
MARDI
Petit déjeuner : Pain, pommes de terre. On a découvert l’Amérique.
Déjeuner : trois cent deux œufs. Révolution culinaire en Europe.
Diner : un chewing-gum de marque Eadweard Muybridge mâché longuement.
MERCREDI
Petit Déjeuner : Une soupe, en souvenir de l’ancien temps.
Déjeuner : Un filet de bœuf méthodiquement haché. Cogito ergo sum
Diner : Des salades. Respiration et photosynthèse.
JEUDI
Petit Déjeuner : du beurre avec du beurre. Lewis Carroll et les surréalistes.
Déjeuner : une poule. En Mésopotamie, elles ne pondent pas d’œufs.
Diner : Choux violet. Alexandre le Grand, ôte toi de mon soleil.
VENDREDI
Petit Déjeuner : Nutella. La gouvernance mondiale de la junk food
Déjeuner : Lieu arc-en-ciel. Hétérotopique.
Diner : Une tarte à la viande. Souvenir de guerre.
SAMEDI
Petit Déjeuner : Du sucre en poudre. Mange ton poing et garde l’autre pour demain.
Déjeuner : Salade d’orties. Douleurs épistémologiques post relativité.
Diner : Une réduction de festin. Biochimie moléculaire et ADN découvert.
DIMANCHE
Petit Déjeuner : Sandwich jambon-fromage. Nationalisme triomphant.
Déjeuner : eau de source. Deus sive natura.
Diner : Croissant de lune. La mort de Dieu.
Barthes, l’art et le goût
Le goût c’est le goût
Concevoir une esthétique de l’art pour l’art, C’est ici que le goût est très utile : serviteur commun de la morale et de l’esthétique, il permet un tourniquet commode entre le Beau et le Bien, confondus discrètement sous l’espèce d’une simple mesure. L’artiste n’a pas de morale, mais il a une moralité. Dans son œuvre, il y a ces questions : Que sont les autres pour moi ? Comment dois-je les désirer ? Comment dois-je me prêter à leur désir ? Comment faut-il se tenir parmi eux ? Peu importera donc la substance des arts.
Cette vieille chose, l’art – On le sait, en cette fin de siècle- le mot désignait un mal esthétique, une vulgarité écœurante, intolérable à l’artiste L’artiste peut alors s’identifier mythiquement à un démiurge, qui tire quelque chose de rien En un sens, il n’y a rien en dehors de l’énonciation, mais le plaisir gustatif, lui, échappe à toute réduction, et par conséquent à toute science (à preuve la nature hétéroclite des goûts et des dégoûts à travers l’histoire). Accordez au moins votre goût et vos idées : on se doute que ce n’est pas par simple goût de la poésie, mon goût des choses basques, le goût du bon vin…. (le goût droit du vin) est inséparable de la nourriture. Boire du vin, c’est manger. Car c’est de lui que dépend le goût, c’est-à-dire le bonheur de manger.
Quel est le goût du comblement? Goût de la division : les parcelles, les miniatures, les cernes, les précisions brillantes, la vue des champs, les fenêtres, le haïku, le trait, l’écriture, le fragment, la photographie, la scène à l’italienne.
Détacher est le geste essentiel de l’art classique.
Concevez hors de toute histoire une double origine de la peinture : La première serait l’écriture, le tracé des signes futurs, l’exercice de la pointe (du pinceau, de la mine, du poinçon, de ce qui creuse et strie – même si c’est sous l’artifice d’une ligne déposée par la couleur). La seconde serait la cuisine, c’est-à-dire toute pratique qui vise à transformer la matière selon l’échelle complète de ses circonstances, par des opérations multiples telles que l’attendrissement, l’épaississement, la fluidification, la granulation, la lubrification, produisant ce qu’on appelle en gastronomie le nappé, le lié, le velouté, le crémeux, le croquant, etc. La vie reçoit ici la caution de l’Art, d’un art noble, suffisamment emphatique pour laisser entendre qu’il joue à la beauté ou au rêve. Tout le luxe du goût est dans cette échelle ; la soumission de la sensation gustative au temps permet en effet de la développer un peu à la façon d’un récit, ou d’un langage : temporalisé, le goût connaît des surprises et des subtilités ; ce sont les parfums et les fragrances, constitués à l’avance, si l’on peut dire, comme des souvenirs.
De quoi le goût défend-il de parler ?
De l’Art, de la Pensée, mais cette soumission est sublimée sous l’apparence d’un travail agréable et esthétisée sous celle d’une relation « mondaine » (le paraître y est toujours très fort) Les grands gourmands de la société sont principalement les financiers, les médecins, les gens de lettres et les dévots, c’est un certain profil d’habitudes, bref une psychologie sociale : le goût gastronomique semble lié par privilège soit à un positivisme de la profession (financiers, médecins), soit à une aptitude particulière à déplacer, à sublimer ou intimiser la jouissance (gens de lettres, dévots). La différence, c’est que c’est seulement la consommation qui est générale dans notre culture, non la production : nous comprenons tous ce que nous écoutons en commun, mais nous ne parlons pas tous cela même que nous écoutons ; les « goûts » sont divisés, parfois même opposés d’une façon inexpiable : j’aime cette émission de musique classique qui insupporte à mon voisin, cependant que je ne puis supporter les comédies de boulevard qu’il adore ; chacun de nous ouvre son poste au moment où l’autre le ferme.
L’œuvre est ordinairement l’objet d’une consommation ; je ne fais ici nulle démagogie en me référant à la culture dite de consommation, mais il faut bien reconnaître que c’est aujourd’hui la « qualité » de l’œuvre (ce qui suppose finalement une appréciation du « goût ») Pour goûter ce plaisir, est-il besoin d’une longue culture langagière ? Le « plaisir » cependant – nous l’admettons mieux aujourd’hui – implique une expérience autrement vaste, autrement signifiante que la simple satisfaction du « goût ».
Ce corps qui avait le goût des larmes
On le sait, lâcher des symboles n’est jamais un acte spontané, l’affirmation poétique s’appuie sur des dénégations, des démentis imprimés par l’artiste au sens platement culturel de la forme : la création symbolique est un combat contre les stéréotypes. Rarement, en somme, la situation d’un artiste (combinat de pratique, de fonction et de talent) a été plus claire. Par talent : par ce mot ancien, il faut entendre non quelque disposition innée, mais la soumission heureuse du savant, de l’artiste, à l’effet qu’il veut produire, à la rencontre qu’il veut susciter. La matière traitée par l’artiste ne trouve une place qu’au moment où il la cadre, l’expose, la vend : c’est la place fixée par l’aliénation : là où cesse l’infini déplacement du symbole. La signature n’est plus que la fulguration, l’inscription du désir : l’imagination utopique et caressante d’une société sans artistes (car l’artiste sera toujours humilié), où chacun cependant signerait les objets de sa jouissance.
Pour être connus, les artistes doivent passer par un petit purgatoire mythologique : il faut qu’on puisse les associer machinalement à un objet, à une école, à une mode, à une époque dont ils sont, dit-on, les précurseurs, les fondateurs, les témoins ou les symboles ; en un mot, il faut qu’on puisse les classer à moindres frais, les assujettir à un nom commun, comme une espèce à son genre.L’origine de l’œuvre, ce n’est pas la première influence, c’est la première posture : on copie un rôle, puis, par métonymie, un art : je commence à produire en reproduisant celui que je voudrais être La culture courante est tyranniquement centrée sur l’auteur, sa personne, son histoire, ses goûts, ses passions. L’artiste, qui est un faiseur au troisième degré, puisqu’il imite ce qui est déjà la simulation d’une essence D’où le goût de ce discours pour les balancements, les contreparties verbales, la position et l’esquive des antithèses ; n’être ni pour ceci ni pour cela » L’art ne serait donc jamais paranoïaque, mais toujours pervers, fétichiste. Le monde signifie fortement, puisque tout est pris dans le paradigme du goût et du dégoût. Voilà posée à propos d’un rien (mais le goût implique une philosophie du rien) l’une des catégories formelles les plus importantes de la modernité : celle de l’échelonnement des phénomènes. Mais c’est bien ce même principe de décalage, épuré, qui règle la qualité du goût : le goût est ce sens même qui connaît et pratique des appréhensions multiples et successives : des entrées, des retours, des chevauchements, tout un contrepoint de la sensation : à l’étagement de la vue (dans les grandes jouissances panoramiques) correspond l’échelonnement du goût. L’art occidental, – par rapport au nouvel art intellectuel qui est en train de s’ébaucher, – transforme l’impression en description Il y a deux voix, comme dans une fugue – l’une dit : « Ceci n’est pas de l’Art », l’autre dit en même temps : « Je suis Art. »
Je suis persuadé que ces « arts », nés dans les bas-fonds de la grande culture, possèdent une qualification théorique et mettent en scène un nouveau signifiant (apparenté au sens obtus) Autrement dit, cette culture de notre temps, qui paraît si générale, si paisible, si communautaire, repose sur la division de deux activités de langage : d’un côté l’écoute, nationale, ou, si l’on préfère, les actes d’intellection ; de l’autre, sinon la parole, tout au moins la participation créative, et, pour être plus précis encore, le langage du désir, qui, lui, reste divisé : j’écoute d’un côté, j’aime (ou je n’aime pas) de l’autre : je comprends et je m’ennuie. Lorsque je suis comblé ou me souviens de l’avoir été, le langage me paraît pusillanime : je suis transporté, hors du langage, c’est-à-dire hors du médiocre, hors du général. Le mouvement correctif et perfectif de la parole est le bredouillement, tissage qui s’épuise à se reprendre, chaîne de corrections augmentatives où vient se loger par prédilection la part inconsciente de notre discours (ce n’est pas fortuitement que la psychanalyse est liée à la parole, non à l’écriture : un rêve ne s’écrit pas).
Parole, elle reste, semble-t-il, condamnée au bredouillement ; écriture, au silence et à la distinction des signes : de toute manière, il reste toujours trop de sens pour que le langage accomplisse une jouissance qui serait propre à sa matière. A la parole, on ne peut que rajouter une autre parole. Ìl suffit que je parle, il suffit que ma parole coule, pour qu’elle s’écoule. C’est qu’il n’y a rien à voir derrière le langage, et que la parole loin d’être l’attribut final et la dernière touche de la statue humaine, comme le dit le mythe trompeur de Pygmalion, n’en est jamais que l’étendue irréductible.
En parlant, je ne puis jamais gommer, effacer, annuler ; tout ce que je puis faire, c’est de dire « j’annule, j’efface, je rectifie », bref de parler encore.
Nous tenons, nous continuons toujours le même discours et il faut bien de la patience à ceux qui nous entourent pour supporter de notre part ce qui discours qui reprend, ce discours imperturbable qui est le nôtre toute notre vie. Nous parlons jusqu’à notre mort un seul et même discours, et la mort, c’est la seule puissance qui peut casser, rompre la tenue de notre discours.Le langage est impuissant à fermer le langage, c’est ce que dit la scène : les répliques s’engendrent, sans conclusion possible. Cette imperfection mystérieuse et souveraine, plus belle que l’art achevé et qui est le tremblement du temps. Comme toute clôture, celle d’un langage exalte, assure tous les sujets qui sont dedans, rejette et offense ceux qui sont dehors.
[soundcloud url= »https://api.soundcloud.com/tracks/274623136″ params= »color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false » width= »100% » height= »166″ iframe= »true » /]
Texte lu et bande son diffusé dans la continuité. Lecture lors du colloque organisé autour du centenaire de Barthes à La Petite Escalère, dimanche 27 Septembre 2015.

